Le vent nous emportera : Écrire sur le cinéma
Fixer l’ennemi intime dans la glace, puis imiter Alice en traversant
le miroir : chiche ?
Tu écris depuis toujours, tu écris
depuis un an ; tu écrivais avant d’écrire, tant l’existence alimente
l’écriture (ne jamais fréquenter un « écrivain », au risque de
figurer, méconnaissable, dans l’un de ses livres).
Des nouvelles, des poèmes, des
essais, quelques courts romans, une ou deux pièces de théâtre – tout ceci,
écrit sur trois années environ, disparut d’un seul coup, d’un seul clic, dans la « corbeille »
vite vidée : il faut détruire beaucoup, disait Artaud, et même si
demeurent d’invisibles traces, sur ton « lecteur » C: ou ailleurs (ce
second blog fugace, Un
pont
sur l’océan électronique), tu t’en fiches, tu les considères en simple
exercice (de styles), en échauffement nécessaire avant de passer aux choses vraiment
sérieuses.
Quoi de plus sérieux que le
cinéma ? Quoi de plus puéril, aussi, souvent, hélas !
Ma seule passion, confessait Dreyer,
dans la double acception sentimentale et religieuse du terme, et la tienne à
ton tour (avec la littérature et la musique, un peu moins la peinture et la
bande dessinée), que cet art du vingtième siècle qui faillit ne pas lui
survivre. On parlait en effet beaucoup de mort du cinéma au début de la
décennie 80, avec l’invasion de la vidéo domestique, de la publicité, du clip, de la multiplication des chaînes
télévisées.
Trente ans après, que reste-t-il de
nos amours, quelque part entre Pialat et Trenet ?
La cinéphilie, désormais, ne se donne
plus seulement à lire sur papier, dans les pages des revues dites spécialisées.
Les Cahiers
du cinéma, Le Cinéphage, Impact, Mad Movies, Positif,
La
Revue du cinéma, Starfix ; les ouvrages de Dan
Auiler, André Bazin, Patrick Brion, Michel Chion, Maurice Drouzy, Susan
Dworkin, Michael Powell, Donald Spoto, Aldo Tassone, David Weddle, parmi
d’innombrables, ou presque, en français et en anglais (non par snobisme mais
par disponibilité) : voici une belle constellation de souvenirs
fondateurs, une fréquentation féconde, régulière ou épisodique.
Pour parler une langue, « maternelle »
ou non, pour l’écrire, pour se l’approprier, vous devez en maîtriser
l’orthographe, la grammaire, la conjugaison, la syntaxe, la prononciation (tout
texte écrit devient sonore dans l’esprit du lecteur silencieux), et tous ces
« passeurs », ces « contrebandiers » (pas seulement de
Moonfleet) sur lesquels ils écrivirent, représentèrent d’excellents
professeurs, dans l’étude d’un corpus
d’œuvres essentielles, celles, par exemple, de Hitchcock, Rossellini, Kubrick,
De Palma, Antonioni, Peckinpah. Mais vient un temps où il faut
arrêter de lire les critiques, d’en écrire soi-même, pour se mettre à réaliser
ses propres films, avertissait Dario Argento, en pleine connaissance de cause.
Une vocation contrariée, un appel
sans mise en actes ? Oui et non. L’état actuel du cinéma français, de la
formation à la diffusion, en passant par les financements perfusés de la TV ou
la production encore majoritairement artisanale (même Besson, du haut de son
vil empire, fait office de « travailleur indépendant »), ne laisse
aucun regret. Le « Je est un autre » rimbaldien s’applique également
à chacun. Peut-être devais-tu écrire au lieu de filmer, ta vraie nature dans
les mots bien plus que dans les images, dans les images que suscitent tes mots,
dans l’échange continu entre les deux régimes, si dissemblables et
complémentaires. Tu ne joues pas au cinéaste, encore moins à l’auteur (de
films, d’écrits) et nulle frustration ni dépit ne t’animent. Tu optes
volontiers pour l’art d’aimer, cédant la haine à ses séides.
Tu écris pour célébrer, tu écris pour
des morts – ceux du cinéma, ceux en dehors du cinéma – et tu donnes à lire ta
prose à des vivants, en pastiche des justes propos de Carax sur les métrages.
Tu éprouves du plaisir et de la fierté à écrire (sinon, à quoi bon ?), tu y
passes un certain temps (un temps certain), mais tu te dois d’écrire vite,
d’aller plus vite que les morts. Ta première et dernière lectrice, par-delà les
visages chéris ou amicaux qui rayonnent dans ta nuit, avec ou sans avatar, avec
ou sans pseudonyme – tu écris sous ton « vrai » nom, par facilité,
par franchise –, tu la connais par cœur, très intimement, tu ne te voiles pas
la face devant la sienne (Captain Marvel, super-héros cancéreux sous le crayon
du talentueux Jim Starlin, lui demande avec courage, le seul qui vaille, de tomber
le masque séducteur avant de l’emporter).
Dans la lumière sudiste du jour, dans
la sérénité solitaire des ténèbres, tu sens sa main glacée sur ton épaule, son
souffle doucereux dans ton cou, tandis qu’elle parcourt tes lignes vives et
vivaces. Oh, oui, elle se tient fidèle à tes côtés depuis l’origine (du monde),
bien avant que tu n’écrives et souffres et jubiles et discutes avec l’univers
sans frontières des cinéphiles virtuels. Elle t’attend et te sourit, et, qui
sait, tu la trouveras peut-être jolie, à la fin (du générique)…
Pourquoi écrivez-vous ? Bon qu’à
ça, répondait laconiquement Beckett. Certes, mais encore et toujours pour vivre
dans le présent, transpercé par les flux et les flots du monde, du cinéma,
d’une vie d’homme au début du vingt-et-unième siècle. Tu écris pour ressusciter
les morts, les sensations, les humeurs de ta médiévale mélancolie, de ta
sensualité solaire puisée à l’invincible été de Camus, autre fils du Sud, à
défaut de « ciné-fils ». La voix et le visage de Serge Daney, tu ne
les oublies pas, pas plus que ceux de milliers d’autres avant et après lui, qui
te constituent, te révèlent mille fois mieux qu’une autobiographie.
En écrivant sur le cinéma, que cela
vous plaise ou pas, vous écrivez aussi sur vous-même, sur votre langue, sur
votre vision du cinéma et de la langue. Narcisse dans son miroir brisé ou
Thésée dans son labyrinthe méta ? Tu cherches une Ariane pour te délivrer
de ton reflet, la Faucheuse dans ton dos, Madeleine/Judy devant toi, ni tout à
fait la même, ni tout à fait une autre. Brigitte Lahaie magnifiée par Jean
Rollin ou Gena Rowlands sous l’influence de Cassavetes ne te sauveront pas, va,
mais elles te permettent de relever la tête dans l’épuisement des jours, durant
« l’entreprise de démolition » quotidienne de l’existence, pour
parler comme Fitzgerald.
Quand on aime la vie, on aimerait –
on fréquenterait, de surcroît – le cinéma, ainsi que le clamait un slogan obsolète et
candide ? Bien sûr que non, on fait effrontément le contraire, en pleine
conscience des charmes du tombeau (la salle de cinéma vue par Artaud), du lien
organique et mécanique avec la mort à l’écran. Et cependant, heureusement, on
peut trouver de la joie dans cette nécrophilie fondamentale, parfois ridicule
(on voudrait secouer tous ces trop sages spectateurs, les inviter à
chercher ailleurs leur nectar existentiel, ailleurs que dans ces bouquets de
cimetière, et cela vaut pour toi comme pour eux !), assumée en signe
contradictoire d’ouverture au monde, à un monde redéfini, raffiné par le cinéma
– ne l’appellent « septième art » que ceux qui veulent lui donner une
respectabilité dont il se contrefout,
art populaire et impur par essence –, à des histoires spéculaires, à des contes
de fées pour adultes pervers et idéalistes.
Tu écris avec une subjectivité
suprême, sans employer la première personne du singulier, élémentaire
courtoisie lexicale (dans l’usage de la première du pluriel, il faut lire une
convention fraternelle et non la hauteur royale des hommes de pouvoir de
naguère). Tu espères, et tu découvres avec reconnaissance, que tes foutus fantômes, que tes miroirs
d’ordinateur et de pellicule réfléchissent
bien d’autres vies que la tienne, qu’ils dialoguent avec leurs désirs, leurs
refus, leur univers personnel. Carte et territoire, partage et identité :
l’écriture offre cela, ici et maintenant, alors pourquoi t’en
priverais-tu ?
Tu te fais l’avocat du diable et te
reproches (à peine) ta sentimentalité, toi qui apprécies tant le stoïcien cinéma
d’horreur, toi qui t’intéresses à la pornographie (ni à la mode, ni apologue),
toi qui verses des larmes devant Sirk ou Fassbinder, toi qui te fais le héraut
d’un Julien Duvivier, car tu sais bien que l’objectivité n’existe pas, ni dans
les mots, ni dans les images. Une caméra de surveillance filme selon un axe
particulier, découpe la réalité dans un cadre précis, la transmue en artefact de texture radicalement différente.
Ne cherche pas le « bon mot », le clin
d’œil, l’allusion en coup de coude complice : ils viendront d’eux-mêmes,
équilibrés par deux ou trois idées valant la peine de leur formulation, ils se
différencieront du reste par la singularité de ton rythme, de ton battement de
cœur et de sang. Pas meilleur qu’un autre, pas pire non plus, un parmi des
milliards, dans une envie d’écrire, de louer, de peindre le portrait d’hommes,
de femmes et d’œuvres dans lesquels tu te reconnais, qui te dérangent, qui te
grandissent, qui te feraient presque croire au spirituel dans ton lourd corps
de boue (et tu n’écris pas debout mais assis devant un Samsung RV515
sud-coréen un peu lent : appelons ceci du « placement de produit »,
oui, oui, comme dans la camionnette postale des Visiteurs).
On peut parler de tout en parlant de
cinéma, prête-t-on à Godard ; cela s’avère vrai, cela s’avère bon, et
chaque facette de ton miroir fantomatique constitue une entrée particulière,
une bouche d’ombre abouchée à la lueur du projecteur thématique. Vous qui
entrez ici, de votre plein gré ou suivant la dictature douce du hasard,
conservez toute espérance, et esprit critique, et ardeur à vanter toujours la
beauté, à tenter de la créer par vous-même, dans des notules (tu les baptises
« billets ») ou dans de longs développements (de phrases et de
textes) parfois critiqués. S’exposer, se mettre (très relativement) en danger,
jouer les saint Sébastien hétérosexuel : cela fait partie du jeu, tu ne
t’en offusques pas, ou alors en silence et durant quatre ou cinq secondes. Tu
dois faire avec, passer à autre chose : le Temps presse et détruit tout,
Gaspar ne dira pas le contraire...
Laisser une trace ? Lutter
contre l’oubli ? Hurler dans le désert ? Réinventer la langue,
spécialement celle du cinéma ? N’y pense même pas, et bon courage à ceux
qui tentent l’aventure ! Le changement advenu, la métamorphose au jour le
jour, les bases du langage et de la personnalité, le cœur saignant et tendre
des films (accessoirement, des livres et des disques) – tant de choses à aimer,
à écrire, à mettre en valeur en bouteilles à la mer binaire (1 et 0, nouvel espéranto de la cinéphilie 2.0), et si
peu de temps pour l’oser, le polir, le présenter à autrui. Tu dois
« vivre » en parallèle, payer un loyer, travailler, dormir un peu.
« Faire des films, pour moi, c’est vivre » dit Antonioni, mais
l’écriture sur le cinéma tient du luxe, de l’activité annexe, du hobby crucial. Lumière bleue de l’écran
du portable, oxygène des mots et des images, miel ou fiel des commentaires,
elle mélange, malaxe, mâtine les composants, dans une alchimie qui agit ou pas,
dans un petit miracle littéraire qui survient ou non.
Le numérique change la donne et ne
révolutionne rien. Il offre une « couverture » démocratique, mondiale, planétaire,
à tes propos, qui pourrait te terrifier, t’alourdir de responsabilité. Mais sur
la mer immense, la vague unique surgit, s’abîme aussitôt dans les profondeurs, elle
n’apparaît dans sa puissance qu’un bref instant, le temps d’un soupir, d’une
respiration accordée ou désunie au chant du monde et du cinéma. Capturez-la
vite dans votre viseur, éclair dans la bouteille pour femme fatale parisienne,
acmé médiatique, capsule de cyanure, corne d’abondance, caresse calligraphique ou
grenade à dégoupiller plus tard.
Dans une époque de cynisme lacrymal
généralisé – tu écris contre ton temps, même si tu le vomis moins que Lovecraft
–, le lyrisme devient une arme de célébration massive, un havre de paix se
voulant un écrin pour les films, peu importe leur (mauvais) genre, leur
nationalité (on parle la même langue quand on parle de cinéma ou d’art), leur
budget, leur effet. Un père aime tous ses enfants, un « scripteur » –
aïe, ce terme didactique ! – aime tous ses textes, avec leurs défauts,
leurs difformités, leur tendresse agressive. Qu’ils ne comptent pas sur toi,
paranoïa ou pas, pour t’auto-dénigrer, t’exhiber, mal contemporain sous
obédience dogmatique et psychanalytique. Oui à la réflexivité, au méta
(physique, de préférence, dans la perspective d’un matérialisme athée empli de
foi), mais non à la flagellation, au remords, au dévoilement façon Malraux du
« misérable tas de secrets ».
Le cinéma se passe très bien de toi,
des critiques, des parasites de tout bord, des journalistes accueillant les
VRP, pardon, les acteurs ou les actrices, puisque tout tourne autour de
l’argent depuis Edison et les Lumière, croix de Malte polyglotte d’un art
capitaliste et collectif. Cela ne vous plaît pas ? Vous appelez de tous
vos vœux romantiques un art individuel, éthéré, élitiste ? Désolé, mais
cela ne t’intéresse pas, tu préfères te salir les yeux dans la fange audiovisuelle, afin d’y dénicher
des pépites, des éclats de vérité, de beauté, de majesté. Tu le sais depuis
Baudelaire, au moins, que dans la boue réside l’or, avec un peu de travail, de
générosité, avec un regard singulier, le tien et pas celui de ton voisin, bien
que vous puissiez regarder dans la même direction.
À l’heure du cinéma « délocalisé »,
dématérialisé, à portée de connexion tactile, que deviennent les images de
films, comment mue la langue de et sur le cinéma ? Doit-on éduquer les
masses, la jeunesse, juguler le piratage, modérer les ardeurs acerbes des « forums » ?
La règle peu renoirienne du jeu démontre son absence : mille façons de
parler du cinéma, lui-même art polymorphe, hors du respect du sens – celui que
l’on perçoit – des œuvres, hors de l’étude rationnelle et passionnelle des
formes qui l’expriment.
Tu te moques bien des chapelles, des
fétichismes, des programmes de clocher, de la nostalgie d’hier et du bruit
d’aujourd’hui. Tu écris sur Lang et Fulci, sur Michael Ninn et Gina
Lollobrigida, sur Bollywood et Laurent Boutonnat. Tout ne se vaut pas mais tout
se répond, tout correspond, tout s’irrigue mutuellement.
Tu ne peux pas séparer le monde de
ton corps qui l’éprouve, qui en fait l’expérience. Tu ne peux pas séparer les
films de ton histoire, tressage de Notre histoire commune, avec ou sans
Delon. La machine à fantasmes, à découdre,
à « momification du mouvement », tourne à plein régime, et tu ne peux
pas toi-même t’empêcher de penser, d’aimer, de traduire (tu écris en marchant,
en respirant l’air des villes, en exil et au centre de ton monde).
Amoureux des femmes mortes (Bill Lee assassine/ranime sa Joan adorée, passeport itératif pour Annexie) mais
saluant, au jour le jour (et même autour de minuit !) une correspondante
bien vivante, classique épris de baroque (d’où ton admiration filiale pour le
cinéma de Brian De Palma), au mitan de ta vie (moins, sans doute, fantôme à
demi entre ceux sur lesquels tu écris, entre les morts qui s’ignorent et que tu
rencontres dans ta « seconde » vie) et dans l’éternité fragile des
films (écrire sur le cinéma revient aussi
à traverser l’écran, à vouloir atteindre cette utopie où l’on ne meurt plus, où
l’on jouit avec une épuisante constance, où la matérialité s’abolit dans le
rêve incarné), tu doutes d’écrire longtemps encore.
Un insert, une séquence au ralenti, une parenthèse verbale
enchantée ; d’autres aspirations viendront, ou un dégoût si grand qu’il te
réduira à la page blanche (tu ne crains pas cela, pied à pied, mot à mot, image
après image). Des mots, des mots, des mots, se lamentait Hamlet, et tu ressens
une fatigue existentielle en même temps qu’un appétit pour cet art familier, mystérieux,
trivial et cosmique, partagé, mort et enterré, sans cesse ressuscité, ton
double, ton reflet et ton frère.
Un jour, le miroir se brisera, tu le
sais, sans Kim Novak ni Liz Taylor, cette fois. So what ? Le monde
continuera, le cinéma aussi, la Toile résistera mieux que le plomb, ou se dissoudra
dans les mémoires, dans le vide d’une écriture qui n’existera plus. Sur la
plage de Lewin ou de Kitano, les traces amoureuses et ludiques s’effacent, le
vent et l’eau emportent tout, gentiment, impitoyablement, avec le poème de
Kiarostami et la chanson de Noir Désir.
Tais-toi, maintenant, écoute d’autres
voix et apprête-toi à suivre d’autres chemins : tu dois te réinventer à
l’horizon des frères humains – le cinéma radieux niché dans ta chair éphémère...




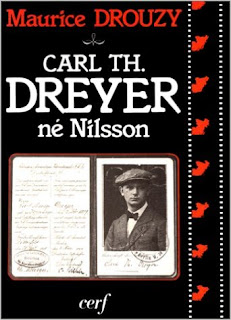







Cultiver un jardin commun plein d'images animées d'un peu d'espérance au milieu de l'immense décharge du monde dit civilisé...demandez le programme, bonbons
RépondreSupprimeret chocolats glacés en prime !
https://www.youtube.com/watch?v=5nUBWPbJFAU
Supprimer